
Au terme de plus de deux ans de travail, la revue systématique COHNECS-IT a été publiée dans le journal Environmental Evidence (Villemey et al., 2018). Cette revue systématique traite du rôle d'habitats et de corridors pour les insectes des dépendances d'infrastructures linéaires de transport (routes/autoroutes, voies ferrées, voies fluviales, gazoducs, lignes électriques).
Selon la méthode (Jeusset et al., 2016) qui définit le protocole de la revue, près de 65000 publications ont été récupérées puis triées. Après une analyse critique, une centaine d’articles portant sur les insectes ont été exploités. Une méta-analyse, réalisée à partir de 34 études, a montré que l’abondance en insectes était similaire sur la dépendance par rapport à des milieux naturels analogues, voire même parfois supérieure pour les insectes pollinisateurs et herbivores sur les routes, hors autoroutes. Par ailleurs, la « naturalité » des dépendances semble exercer un effet bénéfique ainsi que le paysage qui environne la dépendance.
Cette revue systématique, une première en France sur la biodiversité, a été pilotée par l'UMS PatriNat en collaboration avec le CESCO, le Cerema, l'Inra, l'Irstea et l'UPMC, en réponse à un appel à projet du CILB, du MTES (ITTECOP) et de la FRB.
Lien vers l'article :

Trois institutions rassemblées autour d’une expertise scientifique sur la nature
La création de cette unité au Muséum répond à une volonté de rapprocher les compétences et les moyens des trois organismes pour une expertise encore plus pertinente sur la biodiversité et sur la gestion des connaissances sur la nature. Ainsi, le Muséum apporte un ancrage historique et scientifique fort dans le domaine des sciences naturelles (recherches en écologie et en taxonomie, collections de spécimens et de données numériques). L’AFB apporte sa capacité opérationnelle et technique pour mettre en œuvre les politiques environnementales de l’État. Enfin, le CNRS permet de renforcer les liens entre recherche et expertise nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux actuels et futurs.
Lien vers le communiqué de presse
Premier comité de pilotage de l'unité
A la suite de la signature de la convention, les présidents et directeurs des différentes tutelles et de l'unité se sont réunis à huis clos pour discuter des grandes orientations de travail de cette nouvelle UMS. Ce comité est chargé d’établir le projet stratégique pluriannuelle de l’unité. Il valide les décisions soumises à son approbation par le directeur de l’UMS concernant les conditions générales de fonctionnement, en particulier les moyens alloués, et examine le bilan de ses activités. Ce premier comité a notamment officialisé la gouvernance de l’UMS avec le directeur Jean-Philippe Siblet, secondé par deux directeurs adjoints Laurent Poncet et Julien Touroult.
Fin 2017, l’unité se compose de 107 agents respectant une stricte parité. 73 agents sont rattachés à l’AFB, 33 au MNHN et 1 à l’IRD. Cela constitue 80% de postes titulaires ou en CDI. En plus de l’équipe administrative, la structure se compose de 12 équipes avec des spécificités techniques et métiers (Organigramme).
L’unité est localisée principalement sur trois sites : à Paris pour les trois quarts des effectifs, à Brunoy et à la station marine de Dinard.

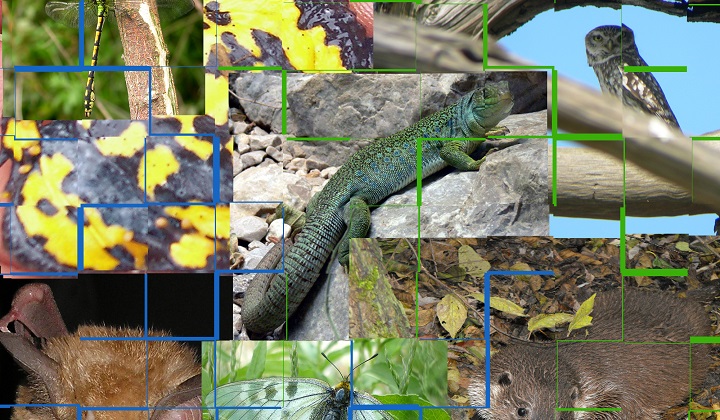
L’évolution des connaissances scientifiques en écologie a peu à peu amené les politiques publiques de protection de la nature à élargir leur approche, afin d’intégrer la dimension dynamique, spatiale et temporelle, de la biodiversité. C’est ainsi que, dans l’éventail des politiques du Ministère de l’écologie, se trouvent à la fois la politique des Plans nationaux d’action pour les espèces menacées (PNA) et la politique Trame verte et bleue (TVB). Alors qu’elles poursuivent l’objectif commun de préservation de la biodiversité, ces deux politiques ont une approche relativement différente : la première est « espèce-centrée » alors que la seconde s’appuie sur la notion spatialisée de « continuité écologique ». Par conséquent, la question des relations (synergies des actions, mutualisation des moyens, ...) entre ces deux approches et politiques se pose.
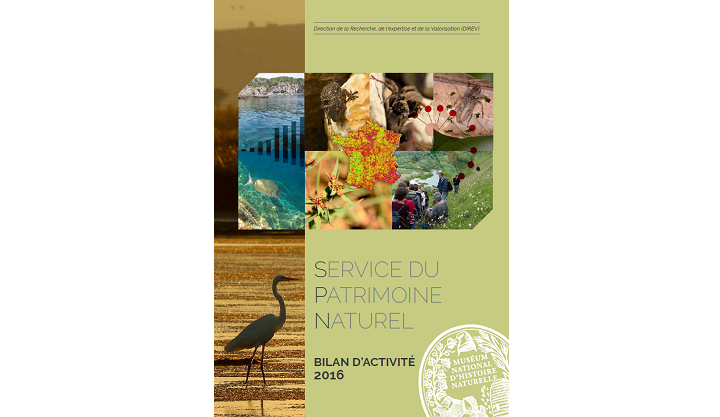
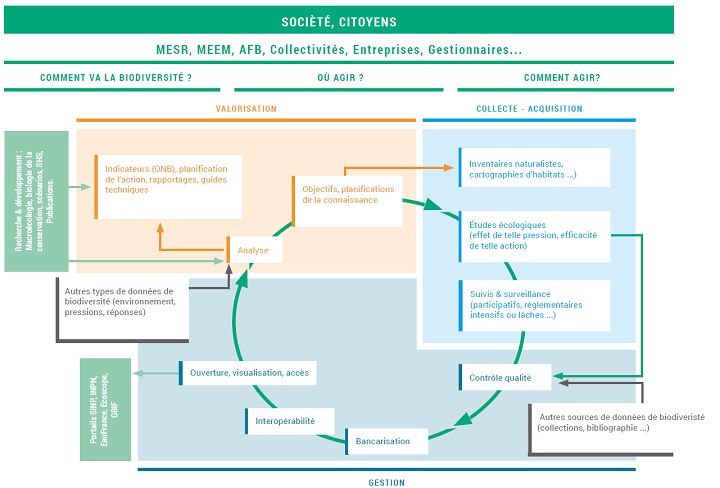

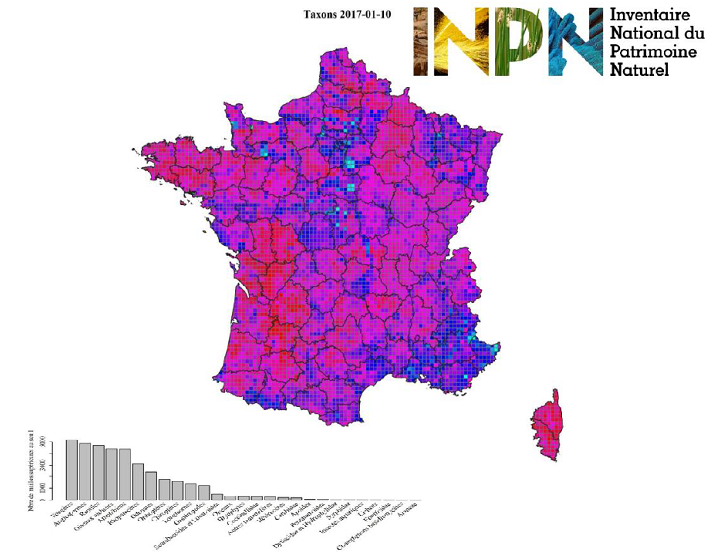

Depuis quelques années, le Service du Patrimoine Naturel (SPN) au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) organise annuellement une sortie « nature et cohésion » pour son personnel. La sortie naturaliste de l’année 2016 s’est tenue dans l’Indre au sein de la Réserve zoologique de la Haute-Touche du 1er au 3 juin. Ce lieu riche en espèces captives, l’est également en espèces sauvages. L’inventaire a permis de recenser 718 taxons non captifs, pour plus de 1 592 données d’observations. De nombreuses espèces patrimoniales ou protégées ont été contactées ce qui laisse présager d’une bonne potentialité du site en matière de biodiversité. Cet inventaire « éclair » a mobilisé des spécialistes du MNHN et d’autres établissements, comme l’Office National des Fôrets, le Parc Naturel régional de la Brenne et le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. Les données collectées ont notamment pour objectif d’alimenter les réflexions et d’améliorer la prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre du renouvellement du plan de gestion forestier de la réserve.
